LA LOI 101 AU CÉGEP
Données
À la lumière des données disponibles, rappelons qu’en 2015, 4 200 finissants du secondaire francophone, dont 1 950 allophones et 2 250 francophones, avaient décidé de poursuivre leurs études en anglais.
Entre 2011 et 2015, parmi les 53 865 nouveaux inscrits au cégep anglophone, seuls 24 127 étaient de langue maternelle anglaise. Ainsi, les francophones et les allophones y sont en nombre plus élevé. En comparaison, pour la même période, les institutions post-secondaires françaises ont attiré seulement 10 000 étudiants n’appartenant pas à leur clientèle habituelle. De ce nombre, en 2015, à peine 427 étaient des anglophones de langue maternelle. Sur l’ile de Montréal cette année-là, seuls 41 finissants du secondaire anglophone se sont inscrits au cégep français.
Même si la population du Québec ne compte que 8 % de locuteurs de langue maternelle anglaise, les cégeps anglophones attirent environ le quart de tous cégépiens inscrits dans les programmes pré-universitaires. En 2016 à Montréal, où le poids des anglophones correspond à 17,4 % de la population, le pré-universitaire anglais obtenait rien de moins que 46,6 % de l’ensemble des inscriptions dans ce secteur.
La « liberté de choix »
Chaque fois qu’il est question d’appliquer la loi 101 au collégial, on nous rétorque : « j’ai la liberté de choix » ; « j’ai l’doua » !
Les politiques relatives à l’instruction publique dans une société et, a fortiori, celles qui touchent à la langue de l’instruction publique, relèvent essentiellement d’un choix collectif, et non d’un choix individuel. Or, il y a 40 ans, nous avons pris la bonne décision, collectivement, en faisant du français la langue officielle au Québec, tout en garantissant à la communauté d’expression anglaise, le maintien de ses institutions et de ses droits consacrés. Ainsi, les écoles anglaises allaient être destinées, comme il se doit, à servir la minorité historique anglaise, et non plus à angliciser l’ensemble du Québec.
Lorsque, sous l’impulsion de Camille Laurin, le gouvernement du Québec a fait adopter la loi 101, cela a donc eu pour effet, oui, de limiter raisonnablement la liberté de parents allophones, notamment, qui pour la vaste majorité à l’époque, envoyaient leurs enfants dans les écoles primaires et secondaires de la minorité. C’était là une décision collective et démocratique ; une décision légitime, naturelle, nécessaire pour le bien commun et, surtout, courageuse.
Par ailleurs, à proprement parler, dans le débat sur la loi 101 au cégep, personne ne remet en cause la liberté d’un étudiant non-anglophone de s’inscrire au collégial anglais. Simplement, il est anormal que la facture qui accompagne ce choix individuel soit assumée entièrement par l’État.
La collectivité des « payeurs de taxes » québécois détient, elle aussi, une liberté de choix : celle de financer, ou pas, sa propre anglicisation. Bref, si ladite collectivité exerçait sa liberté de choix en appliquant la loi 101 au collégial, rien n’empêcherait pour autant un jeune étudiant déterminé à suivre un parcours immersif en anglais, de s’inscrire à un collège privé non-subventionné anglophone, – mais en payant de sa poche. D’une manière ou d’une autre, la liberté, ça se paye. La question est de savoir : qui paye ?
« Ce sont des adultes »
Même si ce n’est pas l’essentiel, soulignons d’emblée que cette affirmation n’est pas rigoureusement exacte. Dans une bonne proportion, les étudiants ont moins de 18 ans au moment de leur inscription au cégep.
Surtout, ce n’est pas parce qu’on est adulte, qu’on a tous les droits. Au contraire, l’adulte a d’ailleurs bien plus de responsabilités que l’enfant. Même dépassé l’âge de la majorité, il faut respecter des règles de vivre ensemble, lesquelles sont déterminées démocratiquement dans l’intérêt commun. Or, la question qui doit orienter le débat, ce n’est pas de savoir si un adulte devrait être considéré plus ou moins libre qu’un mineur, mais si l’idée d’appliquer la loi 101 au cégep se révèle cohérente avec cet intérêt commun.
En l’occurrence, d’aucuns laissent entendre qu’en complétant son secondaire français, « l’adulte » québécois est désormais imperméable à l’anglicisation ; qu’il a tout compris de la société où il vit. Ceux-là font fausse route. C’est précisément au sortir de l’adolescence qu’on parachève sa socialisation. C’est lors de ce moment charnière de son existence qu’on fait son entrée dans le monde du travail, qu’on construit son réseau… C’est au cégep qu’on approfondit sa connaissance de la culture québécoise, de l’histoire et de la réalité de ce pays… Quel meilleur gage d’intégration et d’inclusion pour les allophones que d’aller au collégial français ? Quelle meilleure façon de découvrir et d’apprendre à aimer le Québec ?
Autrement, à la lumière des recherches de l’Institut de recherche sur le français en Amérique (IRFA) sur les comportements sociaux et culturels des allophones et francophones ayant fréquenté le cégep anglais, force est de constater que même les jeunes adultes sont sujets à l’anglicisation, pas seulement les enfants…
Et c’est sans compter les importantes répercussions dans le monde du travail, alors que parmi les étudiants ayant complété leurs études post-secondaires en anglais, 75% des allophones et 50% des francophones gagneront par la suite leur pain dans la langue de Shakespeare. En comparaison, 95% de tous ceux ayant fréquenté le réseau post-secondaire français travailleront dans cette langue.
« L’anglais est mal enseigné dans les écoles françaises »
Si c’était réellement le cas, comment se fait-il que sur l’ile de Montréal, 79% des jeunes francophones sont bilingues, soit légèrement plus, d’ailleurs, que leurs concitoyens anglos, dont le bilinguisme affiche un recul ces dernières années, à l’instar de celui, déjà bien maigre, de leurs homoglottes du Canada anglais ?
Mal fondée empiriquement, cette objection relative à la supposée mauvaise qualité de l’enseignement de l’anglais, langue seconde, est sur toutes les lèvres. Injustement insultante pour le corps enseignant qui se démène déjà comme un diable dans l’eau bénite, elle est censée nous convaincre que le peuple québécois, déjà l’un des plus bilingues sur la planète, ne le sera jamais assez. Aller à l’école anglaise serait une condition essentielle pour réussir dans la vie ! Autrement dit, réussir n’est pas français.
Pour les anglomanes, être bilingues, même à 79%, cela ne suffit donc pas, apparemment. Pour eux, parmi toutes les matières qu’on nous enseigne à l’école, l’anglais semble être la seule qui soit véritablement pertinente. Que l’histoire, la géographie, les sciences et, par-dessus tout… le français, soient tout aussi mal enseignés, cela leur est égal… Seul l’anglais permettrait de s’ouvrir au monde. Et peu importe qu’on n’ait rien à lui dire, à ce monde, en autant qu’on le dise en anglais !
Dans la mesure où l’on admet comme louable l’objectif d’améliorer le niveau de connaissance de l’anglais chez les individus, en quoi faudrait-il pour ce faire, angliciser toute une société ? Faut-il absolument, pour apprendre l’anglais, étudier en anglais pendant deux-trois ans, si ce n’est davantage ? Si l’immersion dans un autre environnement linguistique s’avère évidemment un moyen efficace pour quiconque souhaite devenir parfait-bilingue-pas-d’accent, cette « immersion » doit-elle nécessairement passer par un parcours académique intégral, premièrement ? Deuxièmement, pourquoi un séjour aussi long au Québec, où l’environnement devrait être français, dans des institutions destinées à la minorité anglophones financées à 100% par le public ? N’y a-t-il aucun autre moyen de cultiver son « bilinguisme », c’est-à-dire sa diglossie ?
Allons ! Il n’y a bien qu’au Québec qu’on voit ça. Plusieurs pays, notamment européens, ont une population affichant des taux élevés de connaissance effective de l’anglais, sans pour autant qu’il ne leur vienne à l’esprit de financer de manière illimitée un réseau d’éducation publique parallèle en anglais !
En voulant guérir les pauvres Québécois handicapés du fait de ne pas être nés anglophones, ceux qui prônent l’accès tous azimuts aux cégeps anglais ne font qu’accélérer l’hémorragie sans fin qui, chaque jour qui passe, affaiblit le français, langue commune.
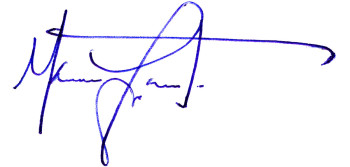
Maxime Laporte
Président général, Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal
